“La grande vertu attachée à cette théorie [ du signal ou de l’information] est qu’elle évite (...) de perdre du temps à essayer de prouver que des systèmes non viables fonctionneront quand même ! Si l’on dispose d’une théorie générale, sufisamment simple dans ses applications, qui établisse qu’un résultat particulier n’est pas possible à atteindre, il est alors souvent très facile de localiser le défaut qui se cache dans une chaîne compliquée de raisonnements faits pas à pas, laquelle prédit des résultats beaucoup trop optimistes. Sans théorie générale, les faux raisonnements sont beaucoup plus difficiles à détecter1.”
A. H. W. Beck.
Il existe de nombreux systèmes d’interprétation des rêves, de nombreuses écoles qui disputent entre elles de la question. Pour qui aborde ce domaine, il est difficile de choisir entre les diverses propositions et même entre les argumentaires de leurs partisans. Devant cette pléthore de théories plus ou moins contradictoires, il nous a paru nécessaire de reprendre le problème à la racine, avec l’aide des méthodes d’expertise utilisées en sciences dures pour tester la validité d’une hypothèse lorsqu’une expérience cruciale n’est pas suffisamment décisive. On dispose alors d’un moyen fiable pour revoir l’ensemble de la question : la théorie des systèmes (dite souvent “systèmes experts”). Il ne s’agit pas de comparer entre elles les théories existantes mais de définir les critères de validité auxquels doit répondre toute théorie actuelle ou future pour tenir compte des données du problème. L’apparente simplicité de cette méthode ne doit pas faire illusion. Il est nécessaire de revenir à des considérations très élémentaires pour déjouer les mécanismes d’auto-persuasion connus comme “effet eurêka”, la tendance à croire validée une hypothèse parce qu’elle semble élégante, heuristique ou simplement parce que l’on vient de la trouver.
Qu’est-ce qu’interpréter un rêve ?
Interpréter signifie donner du sens. L’interprétation se présente comme une opération visant à établir un système d’équivalence entre les éléments d’un rêve et des significations, qui peut se résumer par la formule “tel rêve = cela”. Mais cette opération ne peut se faire au hasard : en ce cas, chaque cliché onirique élémentaire se verrait attribuer une étiquette arbitraire, anarchique ! Il faut donc trouver une manière non aléatoire de donner du sens. Réciproquement, lorsque l’on affirme que “tel rêve = cela”, “cela” renvoie à un arrière-fond, à une théorie du rêve, que cette dernière soit explicite ou non. Mais une théorie non dite, voire inconsciente, fonctionne aussi bien qu’une autre.
Prenons un exemple extravagant, et raisonnons par l’absurde : la théorie veut que le rêve serve à creuser des puits. Dans un premier temps, je peux passer ma vie à noter mes rêves et constater qu’il n’apparaît aucun trou dans mon jardin. C’est l’étape empirique où l’on consigne l’échec du fait souhaité confronté à la réalité du rêve. Elle n’invalide pas forcément la théorie, mais sa mise en oeuvre “naïve”. Il manque manifestement quelque chose. Sachant alors que la construction d’un puits exige une méthode, on peut se demander si le rêve donne les moyens d’apprendre à creuser un puits ou (plus fin) d’apprendre à découvrir où sont les outils pour creuser. Dans cette seconde étape, admettons qu’un rêveur se voie en train de creuser un puits onirique. Il peut en tirer des éléments, mais ce seront des éléments bruts. Voir quelqu’un creuser un puits ou construire un récepteur radio ne donne pas forcément l’ensemble de la technique. Même cette réussite partielle implique une réflexion sur la théorie de départ : qu’est-ce que creuser un puits ? comment s’y prendre ? Dans ce cas, le rêve renvoie à la théorie sur le rêve.
Il existe une autre option lors de cette seconde étape, celle où le rêveur ne voit jamais creuser de puits onirique, où le rêve ne renvoie pas d’éléments clairs applicables à la construction d’un puits. Si on n’abandonne pas cette théorie, on est forcé d’admettre que, si le rêve apporte des éléments de solution, ils seront codés. En définitive, derrière toute explication naïve du type “le rêve, c’est...” ou “le rêve, ce n’est que...”, se révèlent deux gloses obligatoires.
1. Un problème de codage/décodage.
2. Une réflexion en profondeur sur le sens de la théorie. Si “le rêve, c’est X”, que veut dire X ?
En conclusion, toute interprétation des rêves suppose l’existence d’une théorie sur le rêve, et rendre efficace ou utile une interprétation oblige :
1. à parler du décodage du rêve ;
2. à se poser de réelles questions sur le sens que l’on donne au monde onirique.
Elaboration d’une théorie
Admettons que nous nous trouvions aux origines de l’humanité, ou isolé depuis l’enfance dans une bulle, sans aucune transmission culturelle d’une théorie même implicite sur le rêve. Mais nous rêvons et nous cherchons à élaborer une telle théorie à partir d’une collection de rêves. Immédiatement se pose l’immense problème de l’induction.
1. Qu’est-ce qui justifie que, ayant bien expliqué 50 rêves, ma théorie sera valable pour le 51e, le 52e, etc. ?
2. Plus j’aurai de rêves en mains, plus il sera difficile de trouver un exposé non contradictoire avec l’ensemble ou avec des éléments de l’ensemble. Pour sauvegarder ma théorie, il me faudra donc éliminer des faits gênants, en les considérant comme négligeables.
Mais jusqu’à quel niveau les faits gênants ne sont-ils pas compromettants pour le bon équilibre du système théorique ? Si une théorie est valable pour 50 rêves et que le 51e s’intègre mal, je peux l’éliminer, surtout si le 52e, le 53e, etc., rentrent dans le cadre. Je peux supposer qu’il ne s’agit que d’une fluctuation sans importance. Mais que se passe-t-il si le 51e est gênant, les suivants conformes à la théorie, le 61e et le 71e s’en écartant de nouveau ? Je peux penser que ces écarts obéissent à une loi statistique : toujours un fait gênant sur 10. Mais pourquoi existe-t-il des rêves dont l’interprétation sort de la théorie, et ce régulièrement ? Qu’est-ce que cela veut dire ? Dans la réalité, la régularité des écarts ne sera pas aussi stricte que dans notre exemple. Mais il suffit qu’ils se prêtent à statistique pour que la question se pose.
3. Un autre problème montrera le danger d’éliminer les faits gênants. Si j’interprète tous mes rêves sur un an grâce à ma théorie et qu’il n’y ait que 2 ou 3 écarts, je peux supposer que cette théorie restera valable l’année suivante, et même la troisième. Mais la quatrième ? Puis-je dire que, si une théorie est valable localement, elle le restera sur 4 ans, voire pour toute ma vie ? Comment passer d’une expérimentation locale à une généralisation ?
Prenons un exemple. Je pose une feuille de papier sur le sol, donc à la surface de la Terre. En supposant que j’aie éliminé les graviers et les touffes d’herbes, cette feuille reste plane. Je trace alors deux droites parallèles. Je choisis un point sur chacune des droites et je mesure leur écart, mettons 50 cm. Puis je prends A’ à 25 cm de A, sur la même droite, et B’ à 25 cm de B, dans le même sens, sur l’autre droite. Leur écart est toujours de 50 cm. Que se passe-t-il si je continue de prolonger mes droites, à l’aide par exemple d’un système optique ? Sur 1 km, je vais déjà constater quelques mm d’écart. Pourtant, si j’avais fait glisser ma feuille de papier sur cette distance, je n’aurais pas trouvé de différence notable localement. Mais si elle reste en place et que je la prolonge, la distance entre mes points augmente ou diminue selon la direction choisie. C’est donc que j’ai négligé un facteur qui n’a pas d’utilité localement mais prend sens si je continue plus loin. Dans notre exemple, il s’agit de la courbure de la terre.
Il en va de même pour toute théorie scientifique. Admettons que je constate sur un an que “quelle que soit la situation onirique, mes rêves sont ma propriété, ne renvoient qu’à moi-même”. Je m’aperçois que c’est la même chose pour mon voisin : ses rêves sont sa propriété. Mais si je pousse l’induction jusqu’à dire : “En tout temps, pour toute situation, la théorie est valable pour moi comme pour lui, et donc pour tous”, je suppose qu’il n’existe pas de courbure entre l’effet local le concernant et l’effet local me concernant, ou concernant d’autres hommes. Cela signifie, en ce cas, que je néglige les rêves mutuels ou même les objets ou personnages communs. Donc une théorie du rêve basée de manière stricte sur l’intériorité individuelle ne pourra jamais être induite complètement si l’on peut trouver — et c’est toujours le cas — des éléments apparus la même nuit dans les rêves de plusieurs rêveurs. En d’autres termes il faut au minimum prendre en compte une dimension interindividuelle, sociologique ou culturelle.
Apologues sur la courbure
La métaphore de la courbure s’impose d’autant plus que toute théorie scientifique peut s’exprimer mathématiquement dans un espace abstrait, comme l’ont montré de nombreux épistémologues, y compris pour les sciences humaines, en particulier René Thom lorsqu’il affirme : “Toute science est l’étude d’une phénoménologie. Or qu’est-ce qu’un phénomène ? Etymologiquement, un phénomène est ce qui se voit, ce qui apparaît, et toute apparence se manifeste sur un certain espace. Bien entendu, dans la plupart des cas, cet espace n’est autre que l’espace-temps euclidien dans lequel se déroule la morphologie usuelle de la réalité quotidienne. (...) Pour de nombreuses disciplines scientifiques, l’espace substrat de la morphologie étudiée n’est plus l’espace-temps usuel. (...) On devra substituer à l’espace usuel des espaces dérivés, comme des espaces de moments ou des espaces de Hilbert2.” Notons que Thom a élaboré les modèles mathématiques permettant au sociologue de l’imaginaire Gilbert Durand de préciser sa théorie srtructurale des images mythiques fondamentales ou mythèmes, ce qui peut avoir quelque incidence sur l’étude du rêve.
Donc pour maintenir un parallélisme strictement euclidien dans notre espace abstrait, c’est-à-dire affirmer la non communicabilité stricte entre deux univers oniriques, il faut que n’existe aucun élément commun à partir de quoi l’on pourrait déceler une courbure entre ces deux univers, c’est à dire des points où ils se rejoindraient. Mais s’ils ont une partie dense commune, l’extrapolation “en droite ligne” à partir de ces deux univers va permettre de la mettre en évidence et de montrer où elle se situe. Analysons la proposition : “Il n’existe aucun élément partagé et commun entre A et B la même nuit”. Si le rêve est interprétable, si les éléments qui le composent peuvent recevoir un sens, alors les éléments oniriques doivent être envisagés comme une information. On peut donc appliquer, à ce niveau, la théorie de l’information, avant même d’examiner concrètement les contenus oniriques et les théories qui en rendraient compte.
Pour être totalement rigoureux, il faudrait exposer la théorie de l’information sous sa forme mathématique. Mais par égard pour nos lecteurs, nous la présenterons de manière imagée, à partir d’apologues dont le caractère “simpliste”, encore une fois, ne doit pas faire illusion. Supposons une planète dont tous les habitants vivent en autarcie chacun sur leur domaine, et sont auto-suffisants. Ils ne communiquent jamais entre eux, mais disposent à l’origine des mêmes outils. Comme ils sont auto-suffisants, on peut inférer des activités de Jules, globalement, celles de Pierre, Jacques ou Philippe. Introduisons un élément supplémentaire : la télévision. Chacun a son poste et reçoit passivement les émissions. Cependant, il faut que quelqu’un les alimente, quelqu’un qui devra, et lui seul, communiquer avec les autres. Si, de temps à autre, apparaît un inventeur qui met au point pour lui-même de nouveaux outils, au bout d’un certain temps, tout le monde aura pu en entendre parler et les reproduire pour son propre compte. Même si A et B ne communiquent pas entre eux, le truchement du centre de communication extérieur fait que quelque chose passe et l’on peut démontrer que c’est équivalent à une communication directe, mais ralentie, entre les deux protagonistes.
“Tout le contenu du rêve ne relève que du rêveur” n’a de sens que si l’on n’introduit pas la TV dans l’univers cloisonné des rêveurs. Comme il existe une intercommunication à l’état de veille entre les êtres humains, cela supposerait que rien de ce qui est reçu d’autrui à l’état de veille ne pourrait passer dans le rêve. Cependant, à l’état de veille, l’information est reçue à la fois consciemment et inconsciemment (ou subconsciemment : nous nous référons ici aux expériences de perception de signaux subliminaux, sans préjuger d’une théorie particulière de l’inconscient). Admettre donc une cloison étanche entre veille et rêve serait admettre que, dès que quelqu’un s’endort, il efface totalement les acquis diurnes conscients et inconscients. Admettons que ce soit le cas pour les acquis conscients. Mais si j’ai vu à la télévision un reportage “imbitable” sur les “supercordes” en cosmologie, même si je n’y ai rien compris, mon inconscient aura retenu les images fortes et simples des créateurs de la théorie, celles qui correspondent à mon expérience cognitive : il est question de symétries par exemple. D’autre part, j’aurai enregistré la gestuelle du savant, ses intonations de voix, le langage corporel par lequel il va souligner les points clefs de sa démonstration. Consciemment, je n’ai rien compris mais mon inconscient aura reçu et classé des informations, dont certaines ont été émises consciemment par le présentateur et d’autres inconsciemment. Quand je m’endors, si j’oublie le discours transmis et reçu consciemment, en sera-t-il de même de la part transmise et reçue inconsciemment ? Or ce serait la seule hypothèse qui me permettrait de considérer le rêve comme un innerworld, une production purement individuelle et sans interaction avec d’autres rêveurs.
Dans l’exemple du savant, on a circonscrit l’émission et la réception du signal. Mais si l’on ne sait pas définir les media utilisés et comment s’opère la transmission, entre en jeu un élément mathématique d’indécidabilité. On ne sait pas s’il existe un échange objectif direct, un échange médiatisé ou une simple coïncidence. On ne peut pas trancher.
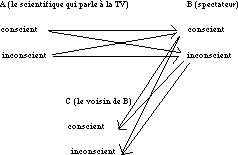
est absolument équivalent à :
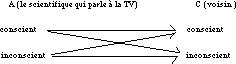
D’autre part, au bout d’un certain temps, la communication s’établit dans les deux sens, avec plus ou moins de retard, plus ou moins d’interactions intermédiaires. Si l’on ne peut pas retracer exactement les voies de transmission des signaux, tout se passe comme si ces intermédiaires n’existaient pas3. Et lorsque la communication passe d’inconscient à inconscient, le choix entre les propositions “il doit y avoir des intermédiaires” et “c’est de la télépathie” est rigoureusement indécidable. Il dépendra en tout cas d’autres hypothèses ou croyances que de la théorie du signal.
Le rappel onirique prouve qu’il existe une communication dans le sens moi de rêve vers moi de veille. Mais le moi de veille est en interaction avec les autres. Donc, selon la théorie du signal, il doit s’établir au bout d’un certain temps une communication dans le sens moi de veille vers moi de rêve. Et même une communication entre les moi de rêve de différents rêveurs. Plus le nombre d’interactions augmente et se diversifie, et plus il devient indécidable de savoir si cette communication est directe ou médiatisée. Ce qui ne signifie pas que le signal sera immédiatement reconnaissable : plus le nombre d’interactions augmente et plus le bruit parasite risque aussi de croître.
Le filtrage de l’information
Dans la démonstration précédente, nous avons supposé que toute l’information passait. Mais que se passe-t-il s’il existe un filtre ? Dans notre apologue du monde cloisonné, supposons que la TV permette de reproduire des outils simples, mais pas des outils complexes. Admettons que l’outillage de base comporte 4 objets. On peut les coder selon le système binaire 00, 01, 10, 11. Si je ne peux recevoir que ces codes, effectivement les outils nouveaux ou plus complexes sont hors de ma portée puisqu’il faudrait les coder au minimum avec 3 chiffres. Si l’émetteur envoie une suite de 3 ou 4 “bits”, le récepteur la tronquera. Par exemple, si un nouvel outil porte le code 0111, je ne recevrai que 01 ou 11.
Impossible d’évoluer ou de communiquer dans un tel monde ? Cela signifierait que j’aie une capacité d’oubli instantanée et immédiate. Nous avons vu dans nos exemples précédents que, de toute façon, une partie du message passe du conscient vers l’inconscient et du moi de veille vers le moi de rêve. Il existe, dans le monde réel, une inertie à la perte. En sciences, une inertie est l’équivalent d’une mémoire. Or on ne peut enregistrer que sur une matière (papier, arrangement d’électrons, excitation de neurones, etc.) parce que toute matière est soumise à des phénomènes d’inertie. Si l’axe d’un gyroscope indique le nord, l’effet d’inertie va provoquer la mémoire du nord même si l’avion tourne, c’est même le principe de base d’un tel appareil.
S’il existe une inertie dans le sens moi de veille vers moi de rêve, cela implique que la capacité de la mémoire est supérieure au codage des “outils simplets” de notre apologue. Elle nécessite au moins une “case” supplémentaire qui de temps en temps sera décodée complétement. Donc même s’il existait une censure rigoureuse, à cause de l’effet d’inertie ou de retard dans le sens veille => rêve ou rêve => veille, cette censure ne pourrait jamais être complète. De temps à autre, elle sera franchie. C’est ce qui permet en physique quantique l’effet tunnel et, en cosmologie, l’évaporation des trous noirs4. Notons que c’est cette incomplétude fondamentale qui permet à la censure éventuelle entre inconscient et conscient d’être franchie, fait que constate Freud mais que sa théorie n’explique pas : il dit comment elle se franchit, voire dans quel but la censure existe, mais pas fondamentalement pourquoi elle est poreuse. Curieusement, et nous verrons plus loin ce que nous pouvons en penser, son attitude rejoint celle de l’école de Copenhague en physique quantique, école qui insistait sur l’observable et se refusait à penser la théorie plus en profondeur, faute alors d’outils pertinents pour le faire sans risque.
Les paradoxes de la censure
Nous allons examiner comment va se comporter un individu lorsqu’opère une censure. Même si nous avons évoqué à propos de ce terme la théorie freudienne, les considérations qui vont suivre s’appliquent à n’importe quelle forme de filtrage, y compris le démon de Maxwell.
Admettons qu’il existe une théorie du rêve et des faits qui ne cadrent pas avec elle. De nombreux praticiens, en ce domaine, élaborent une théorie dans un but pratique : un psychologue pour les besoins de l’activité thérapeutique, un spécialiste en “communication” pour augmenter la créativité, etc. Ils n’utiliseront donc dans les rêves de leurs clients que les éléments “utiles”, ceux d’ailleurs qui leur ont permis d’élaborer une théorie assez consistante pour pouvoir éliminer ce qui serait hors cadre. Leur démarche n’est pas tant épistémologique qu’heuristique. De telles élaborations sont parfaitement licites tant que la plupart des chercheurs restent conscients des limites de ces théories, de leur domaine de validité. Or si, par exemple, le rêve apporte des éléments de diagnostic lors d’une cure, a-t-on le droit de supposer que les fonctions du rêve se limitent à cette utilité thérapeutique, que la théorie psychologique X décrit toute la réalité onirique, en d’autres termes qu’elle est complète ?
Revenons à notre apologue des gens isolés sur leurs domaines mais imaginons, cette fois, qu’ils disposent d’un moyen de communication interindividuel. Ce n’est plus un système centralisé ou “maître-esclave” comme la télévision, mais la possibilité de s’envoyer des lettres et d’échanger des produits, un embryon de commerce. Il faut donc prévoir, dans cet univers, un organisme de transport du courrier. Mais admettons que, comme cela se pratiquait encore au début du siècle dernier, ce système de transport serve aussi à d’autres besoins, comme l’acheminement des denrées périssables. De plus, au début, ils s’y prennent mal : ils rédigent leurs commandes comme ils peuvent et les réponses ne sont pas forcément plus claires. Quelques savants éducateurs vont donc se mettre à leur disposition pour leur apprendre comment améliorer les échanges épistolaires. Si la poste transmet autre chose que des lettres, les Aides n’en tiendront pas compte et, à la limite, ne le verront même plus. Lorsque le client sait se débrouiller seul, l’Aide s’en va. Mais comment les autres colis, transportés en même temps que les lettres et vers d’autres destinations, seront-ils perçus par lui ?
Si la seule chose qui compte pour lui, c’est de passer ses commandes de façon à recevoir ce qu’il demande, il ne les remarquera pas plus que l’Aide, sauf accident. Car enfin les autres objets sont dans la charette. Par hasard, le facteur peut lui remettre un colis qu’il n’a pas commandé. Notre homme s’en aperçoit en le déballant : que va-t-il en faire ? Il peut le redonner au facteur, avec des excuses, lors de son prochain passage. Il peut aussi continuer à le considérer comme négligeable, le laisser dans un coin et ne plus le voir, même si le facteur lui affirme qu’il n’y a pas d’erreur sur l’adresse, qu’il s’agit d’un cadeau-surprise. Il peut aussi en tenir compte, s’apercevoir que la charette transporte bien autre chose que son courrier, et élargir son point de vue.
Transposons notre apologue dans le domaine de la thérapie (ou tout autre domaine plus heuristique que fondamental). Un thérapeute redonne à un patient le goût et les moyens de vivre mieux ; ce dernier va s’enthousiasmer pour la méthode qui l’a “guéri”. Il risque alors de faire l’induction maladroite dont nous parlions plus haut et de généraliser la théorie qui lui a réussi sans se poser la question de son domaine de validité. “Si tel mode d’interprétation du rêve m’a “guéri”, alors c’est qu’il n’existe pas d’autres possibilités ni de faits réfractaires, puisque le but du rêve, à l’évidence, est de guérir les maux dont je souffrais.” Fort du “baby duck syndrom5” ou zèle du converti, il va diffuser la bonne nouvelle autour de lui : on a trouvé la théorie du rêve, l’unique et la seule valable. Hélas, le thérapeute qui constate les réussites de sa méthode risque d’avoir aussi la même attitude, au moins jusqu’au premier échec.
La censure théorique semble inévitable lorsque l’on cherche une théorie utile. Il est même souvent indispensable de découper le réel afin de mieux cerner son objet et de ne pas se perdre dans les détails : pour calculer la trajectoire d’un boulet de canon, on peut légitimement négliger les effets relativistes. Il en va de même dans l’observation astronomique mais jusqu’à un certain point. Aux limites du domaine de validité d’une théorie, ou même de manière accidentelle et imprévisible, un fait peut émerger qui ne serait explicable que dans un cadre renouvelé et plus vaste. Un praticien honnête, même s’il les écarte pour se concentrer sur son but, admettra l’existence de phénomènes “gratuits” ou “inutiles”, du moins en apparence.
Au tournant du XIXe et du XXe siècles, Delboeuf rapporte dans son ouvrage Le sommeil et les rêves une anecdote curieuse. Il rêve d’une suite de noms latins qui, dans son sommeil, lui semble familiers : Asplenium Ruta Muralis. Au réveil, cela semble issu d’une nomenclature botanique, ce que confirme le recours aux dictionnaires spécialisés. Mais Delboeuf n’est pas botaniste. A peine a-t-il eu, quelque temps auparavant, la curiosité de se constituer un petit herbier. Il se demande donc où il a bien pu entendre ce nom énigmatique. C’est pourtant dans son herbier qu’il le retrouvera ; il avait, à l’époque où il constituait sa collection, demandé à un ami botaniste de lui dicter les termes savants pour rédiger ses étiquettes6. Une telle réminiscence onirique ne met pas en cause de grands conflits affectifs, ne s’accompagne d’aucune charge émotionnelle et ne correspond en rien aux préoccupations cognitives actuelles du rêveur. Elle apparaît comme un jeu gratuit et anecdotique. Pourtant un chercheur qui voudrait élaborer une théorie complète du rêve ne peut se permettre de la négliger.
Quelques exemples de rêve ou de communication non thérapeutiques
Le premier exemple m’est personnel. A l’âge de 17 ans, j’ai rêvé que je m’éloignais de la Terre et que je plongeais parmi les étoiles. Me demandant comment j’allais retrouver mon chemin dans ces myriades de points lumineux, je me suis brusquement retrouvé de nuit sur une planète, au bord de la mer. Le ciel était extraordinaire : il fourmillait d’étoiles dont la clarté rendait visible le paysage. Je me suis allongé sur le sable pour mieux le contempler. J’ai remarqué la galaxie, mais elle n’emplissait pas la voûte céleste comme d’ordinaire la Voie Lactée, elle apparaissait sur environ un tiers du ciel. Au bout d’un moment, j’ai entendu des pas : quelqu’un venait vers moi. Mais je n’ai pas eu le temps de le voir car je me suis réveillé. En me remémorant le rêve et la beauté de ce ciel nocturne, j’en notais les incongruités. Il y avait trop d’étoiles, la galaxie semblait vue de l’extérieur, et je me dis que c’était bien un jeu esthétique comme on pouvait l’attendre d’un rêve ! Deux ou trois ans plus tard, je suis tombé sur une revue scientifique qui décrivait comment les amas globulaires orbitent autour de la galaxie et comment un observateur situé dans l’un de ces amas verrait le ciel nocturne. C’était exactement ce que j’avais vu en rêve.
Aucune théorie du rêve, à ma connaissance, ne prend en compte de tels échanges d’information complexes et ne pourrait dire s’il s’agit d’une perception directe de la réalité ou d’une communication avec un inconscient collectif cognitif. Même un cadre jungien très large, où l’on pourrait reconnaître dans l’apparition du ciel étoilé le surgissement d’un archétype ou d’un mythème, resterait insuffisant : il ne rendrait pas compte de l’exactitude scientifique de l’image onirique. Pour rester dans le domaine astronomique, je citerai un autre cas, celui d’une artiste sculpteur, Anita Tullio. Cette jeune femme n’a jamais fait d’études au delà de l’école primaire ; pendant son enfance paysanne en Italie, elle aimait à regarder la pleine lune se refléter dans les flaques d’eau boueuse ; adulte, elle réalise en céramique émaillée, avec adjonction de cailloux et autres éléments minéraux, des “planètes” inspirées de ses rêveries d’enfant. Les choses en seraient restées là si elle n’avait pas rencontré par hasard dans un train le plus grincheux des astronomes, notoirement misanthrope autant que misogyne mais observateur de génie et chasseur d’astéroïdes. Lorsqu’il a jeté un oeil distrait sur le press book qu’elle réorganisait en vue de sa prochaîne exposition, il est instantanément sorti du silence dans lequel il se mure d’ordinaire lorsqu’il est forcé de voyager : deux des sphères d’Anita Tullio correspondaient au détail près aux planétoïdes qu’il venait de découvrir quelques jours plus tôt7. Anita Tullio ne cherche pas son inspiration en rêve nocturne, mais avoue se trouver dans une sorte de transe lorsqu’elle réalise une de ses boules de céramique. On pourrait parler, au moins, d’état oniroïde. Mais dans ce cas, il s’agirait plutôt de communication entre son propre “inconscient” et des éléments cognitifs conscients propres à certains astronomes dont elle ignorait jusqu’à l’existence.
Des faits incongrus de cet ordre, inutiles pour toute théorie heuristique, pourraient se collectionner. Même s’ils restent temporairement les hôtes d’un imaginaire cabinet des curiosités, avec le statut de ludus naturae que l’on donnait aux XVIIIe siècle aux rochers ruiniformes, aux branches mortes à tête de dragon ou aux racines de mandragore, ils doivent au moins faire réfléchir sur l’incomplétude de toute théorie qui ne les peut les inclure.
Intermède mathématique
Une théorie représente une information sur un ensemble de faits et peut donc s’exprimer par une fonction de type f = logx puisqu’une information prend toujours mathématiquement la forme d’un logarithme. Si elle croise deux séries de faits, nous aurons f = logx et f’ = logy. Intégrer l’ensemble demande de faire F = logx + logy = logxy et non pas — erreur plus classique qu’on ne pense — log (x + y). Retraduite en langue du pays, cette loi mathématique de composition de l’information signifie qu’une théorie plus englobante ne peut se contenter de rabouter des morceaux de puzzle oubliés. Il faut forcément tout refondre et s’attendre à ce que la nouvelle théorie permette des émergences imprévisibles par l’une comme par l’autre des théories de départ.
D’une certaine manière, pouvoir appliquer la théorie du signal à partir du simple constat de l’existence du rêve, et cela avant tout examen de son contenu, s’apparente au passage à une théorie plus englobante. Du moins, cela nous permet de pointer les exigences auxquelles une théorie complète devrait répondre. Mais déjà à ce stade, nous pouvons supposer que cette théorie englobera davantage que le rêve lui-même. Notre réflexion incidente sur la ressemblance de la démarche de Freud avec celle de l’école de Copenhague nous a incité à voir si l’on ne trouvait pas d’autres faits de communication du même ordre entre physique et psychologie. Faute de données historiques consistantes, nous ne pouvons poursuivre l’exploration en deçà du XVIIIe siècle.
Dates
Physique
Psychologie
XVIIIe siècle
Interactions de surface (modèle du billard)
Homme insulaire, communication par les seuls organes sensoriels et le langage
1845 - 1848
Parson, découverte des nébuleuses spirales etidentification correcte comme galaxies.Les galaxies deviennent des objets autonomespar rapport aux étoiles
Moreau de Tours : assimilation des rêves et des hallucinations,
découverte de l’autonomie du psychisme.
1865 -1867
Maxwell : second principe de la thermodynamique appliqué aux gaz parfaits
Hervey de Saint Denys : rêves
comme mélanges mémoriels. Premières notions de l’inconscient.
1900
Planck : découverte des quanta, les “grains d’énergie” sont repérables par leurs effets mais au delà du mesurable.
Freud : L’interprétation des rêves. L’inconscient, hors de portée de
l’observation, révèle sa structure par ses effets.
1932 - 1935
Théorie quantique des champs. Découverte de l’effet tunnel.
Jung : première approche de l’inconscient collectif, qui agit comme un “champ psychique”.
1939 - 1942
Expérimentation sur la fission de l’atome. Débuts de la théorie de l’information. Les éléments constitutifs de la matière deviennent actifs dans le domaine macroscopique.
Kilton Stewart : élaboration de la “théorie senoï” les éléments du rêve sont actifs jusque dans la vie de veille et non seulement révélateurs de la psyché.
1951 - 1952
Méthode de comptage des particules parscintillation. Chambre à bulles. Maser.Structure fine de la matière.
Kleitman et Aserinsky : à partir de l’EEG, découverte de la structure du sommeil.
1970
Hawking : évaporation du trou noir
Découverte de l’existence d’une forme de communication chez les autistes et les catatoniques
1973 - 1974
Maîtrise de la fission nucléaire, premières piles industrielles
Travaux d’Ullman et Krippner.
Publication de l’ouvrage de Patricia Garfield sur le rêve lucide et la méthode “senoï” : maîtrise du rêve.
1978 - 1980
Prigogine et Stengers : thermodynamique “chaotique”. Théorie inflatoire.
Stephen LaBerge et, indépendam ment, Alan Worsley : communiction directe par signaux oculaires entre un rêveur et un appareil de mesure.
1982
Mise sur pied du Projet Sigma de détection des trous noirs, jusqu’ici objets prévus par la théorie mais à l’existence concrète douteuse.
Premier “rêve mondial”, dans lequel l’idée est lancée sans réelle réalisation.
1990
Lancement de Sigma
Rêve planétaire, réalisé à grande échelle
1991
Janvier : découverte du trou noir Nova Muscae
Début de l’année : mise en évidence d’un mythème accréditant l’hypothèse de l’inconscient collectif
1996
Généralisation des recherches de Sigma existence de novae à trous noirs dans le bulbe galactique. Les trous noirs cessent d’être des objets purement théoriques.
Etude globale du rêve planétaire, mise en évidence d’indices donnant
une consistance expérimentale à l’inconscient collectif.
Ce qui frappe à la lecture de ce tableau, c’est l’émergence de modèles du même type au même moment dans des sciences réputées se placer aux deux extrémités du spectre. Une étude fine montrerait sans doute une partie des voies de transmission de l’information, tout du moins de conscient à conscient. Mais le seul fait d’avoir pu réaliser cette étude sommaire montre qu’il y a intercommunication et qu’elle dépasse sans doute le conscient des chercheurs. Lorsque le premier projet de “rêve mondial” a été lancé, le projet Sigma était encore considéré comme secret. D’autre part, étant donné les préjugés de “boutique”, il est inconcevable dès la fin du XVIIIe siècle qu’un physicien aille chercher consciemment des idées et des modèles dans les sciences humaines ; et de nombreux indices tendraient à prouver que les psychologues leur rendent bien leur ignorance.
La peur du cercle vicieux
Une grande peur (inavouée) du chercheur en onirologie : une théorie du rêve interfère sur le rêve et, à l’inverse, les rêves deviennent un aide à l’élaboration d’une théorie. Nous allons montrer en quoi la matière de l’onirologue interfère avec sa propre élaboration et pourquoi la peur du cercle vicieux n’a aucune raison d’être dans ce contexte. Par contre, nous montrerons quelques conséquences passées jusqu’ici inaperçues, du moins dans la littérature spécialisée.
Le problème des corrélations
Dans le paragraphe précédent, nous avons montré qu’il existe un lien entre les recherches dans des domaines de connaissance bien différents. Certains pourraient invoquer le hasard et n’y voir qu’une coïncidence amusante sans autre signification. Nous avons montré dans un article précédent le lien entre théorisation du rêve et évolution humaine :
Style de modèle
Evolution
Emergence à l’occasion de
Date
Activité onirique associée
Archétype
premiers mammifères
homéostasie thermique,
cortex cérébral
- 70 MA
Apparition du rêve.
Symbole
préhominiens
Outil
-2,5 MA
Attention accordée au souvenir du rêve ?
Métaphore
Atlanthrope ?
Néanderthal ?
Langage articulé
- 500 000 à
- 100 000 ans
Le récit de rêve dans le clan ? Origine de la musique lyrique, du conte, du mythe ?
Allégorie
Sociétés structurées établissant les bases d’une morale ou d’une sagesse.
Apparition de la philosophie.
vers - 800, en Chine, Inde, Grèce.
Le rêve comme aventure ayant un sens personnel.
Emergence du sens de la personne, invention du conte “moraliste”.
Code abstrait
Sociétés ayant besoin de signaux à structure cohérente, complexes et de grande diffusion.
Sémaphore
Télégraphe Chappe
Code Morse
Signalisation routière
vers 1800 et croissance tout au long du XIXe siècle.
Le rêve comme simple signal clinique d’un désordre.
Le rêve comme signe.
Refus social du rêve chez les positivistes.
Montée des magnétistes.
Code abstrait revient exprimer le symbole
Besoin de codes à sens complexe et d’élaborations avec fonction “drapeau” ou “signal”.
Langages informatiques évolués
Le FORTRAN en 1955
Regain de popularité des “clefs des songes”.
Sens des “masses” sociales.
Art abstrait.
Vulgarisation de la psychanalyse.
Code abstrait revient exprimer la totalité complexe et arborescente à héritages multiples
Besoin d’ordres machine pour traiter des problèmes fins.
Intelligence artificielle.Interaction conviviale utilisateur/ordinateur.
Langages orientés objet
Langage C++, 1979
Intérêt pour le rêve dans les sociétés traditionnelles.
Rêve lucide.
Rêve planétaire.
Que signifient ces liens, s’ils ne sont pas le fait du jeu arbitraire du dieu Purhazard ? Ils indiquent l’existence d’une corrélation entre plusieurs séries de faits. Une corrélation signifie un lien de dépendance, donc de cause à effet, entre deux ensembles A et B, c’est à dire qu’il existe une cause C interférant sur A et sur B. L’étude des corrélations pose un certains nombre de problèmes cognitifs. Le plus simple des pièges consiste à penser qu’une corrélation indique toujours que A implique B ou que B implique A, en d’autres termes que la cause C est incluse soit dans A soit dans B. C’est possible dans certains cas, mais très rarement vrai. Reprenons un apologue “simplet” pour le décrire. Mes voisins, je le constate, ont une étrange manie vespérale. Lorsque 20 h sonnent au clocher du village, ils allument leur télévision et je peux constater, surtout en hiver lorsque la nuit tombe tôt, la lueur mouvante du récepteur derrière leurs fenêtres. Vais-je en déduire que le son de la cloche déclenche physiquement l’allumage des TV ?
Il existe des pièges plus difficiles à déjouer. Lorsque j’habitais une grande cité, les soirs où le prestigieux PSG jouait un match décisif, je pouvais entendre des hurlements sortir en même temps de plusieurs appartements du voisinage. La simultanéité de ces bruits urbains me faisait comprendre qu’il existait une cause commune : de l’information “importante” passait à la TV, ce que je pouvais vérifier immédiatement sur mon propre récepteur. Mais une fois ce point établi, j’avais déterminé une cause et non la cause. Poser le problème de cette manière fait éviter les autres composantes. Si quelqu’un menait une étude naïve de ce phénomène et se contentait de cette vérification expérimentale, il resterait à comprendre pourquoi de bons pères de famille plutôt calmes à l’ordinaire se mettent à vociférer dès qu’une poignée de jeunes gens, sous l’oeil de la caméra, tentent d’envoyer un ballon rond dans un filet. Il faut alors prendre en compte des effets sociologiques complexes en se demandant, par exemple, pourquoi le comportement à domicile est le même que dans un stade, ou pourquoi tant de gens ressentent le besoin de s’exprimer au même moment. La cause C n’est que partiellement la diffusion du match le jour J à l’instant t, elle englobe en fait un faisceau de composantes qu’il est nécessaire d’analyser. Un effet pervers des corrélations vient aussi de ce qu’elles sont uniquement spatiales dans leur approche, et oublient le facteur temps. Dans notre exemple, si j’entends des hurlements isolés vers 2 heures du matin, il peut s’agir de la même émission, enregistrée sur magnétoscope. Comment donc corréler des faits sans tenir compte d’un effet temporel, d’un effet de mémoire ?
Dans l’étude du rêve, ces biais de raisonnement existent et sont faciles à mettre en évidence. Qu’importe une statistique annuelle établissant que, sur une population donnée X, 30 % des rêves sont d’origine sexuelle8 ? Il serait beaucoup plus intéressant de suivre les fluctuations d’un jour sur l’autre, entre disons 28 % et 35 %, afin de déterminer l’influence possible de facteurs extérieurs tels que publicités télévisées, films à succès, comment se propage dans le temps ce genre de stimuli, etc. Mais constater qu’environ 1/3 des rêves ont un contenu sexuel reconnaissable sans autre analyse ne saurait constituer que le début de l’étude. Les ébauches de corrélation que nous avons données entre théories physiques et théories psychologiques applicables à l’étude du rêve représentent de manière exemplaire un phénomène de co-évolution dont les effets ne sont perceptibles qu’en tenant compte du temps. Il n’est certainement pas à prendre à la légère et, à défaut de preuve que nous ne possédons pas encore, pas sans étude plus poussée et recherche des causes, il est du moins un indice qu’il y a là quelque chose sur quoi il serait bon de réfléchir.
Rêve et évolution
Dans l’évolution des espèces, le rêve prend un sens extrêmement important. Le temps de sommeil paradoxal, à de rares exceptions près, croît avec la complexité du cerveau. Le rêve aurait donc, semble-t-il, une fonction importante dans l’évolution9. Même si nous ne tombons pas dans le piège réductionniste (“l’évolution, ce n’est que...” l’augmentation du volume cérébral, l’utilisation maximale de l’énergie avec le minimum de déchets, etc., au choix), nous sommes forcé de constater que la croissance de l’activité onirique est concomitante à celle de l’activité créatrice et de l’aptitude à résoudre des problèmes, dans les espèces “pensantes”. Encore faut-il s’accorder sur ce que l’on appelle penser, mais nul ne met plus en doute à l’heure actuelle l’existence d’une intelligence animale.
Un autre aspect irritant du problème concerne la déprivation. Dans les espèces évoluées, la privation de sommeil paradoxal entraîne des perturbations de comportement pouvant aller jusqu’à la mort, et amène en tout cas de grandes difficultés à percevoir la différence entre imaginaire et non-imaginaire (Dement, 1950 et suivantes). Cependant, chez l’homme, il semble que ce ne soit qu’un stade transitoire puisque les insomniaques peuvent survivre10. Là encore, il faudrait s’entendre sur ce qu’est la conscience, ce qu’est l’imaginaire, ce qu’est le réel, pour ne pas se laisser piéger aux éléments de théorie naïfs11. Or tous nos concepts ont une perlaboration, voire une élaboration dans le monde du rêve, qui permet souvent la cristallisation de théories au moment où la réflexion consciente se bloque (voir les rêves célèbres de Kekule et autres), voire donne le déclic qui va faire démarrer une recherche. Ce dernier point est essentiel. Il est plus facile de se cacher la difficulté derrière des bases théoriques naïves que de la poser brutalement : j’étudie le rêve parce que je sais l’impact du rêve sur moi comme sur les autres ; ce faisant, je n’ai pas toujours la réponse à mes questions à l’état de veille, les matériaux cognitifs peuvent s’élaborer de manière cohérente (ou non) dans le rêve lui-même. Il peut m’arriver de rêver que je rêve, mais aussi de rêver que je théorise sur le rêve. Horreur ! Impensable cercle vicieux !
Réponse : Il existe un couplage ? Où est le drame ?
Le cerveau machine et le grand horloger
Quelle est donc la différence entre un cercle vicieux et un couplage ? Pour le comprendre, il nous faut évoquer la conception naïve et inconsciente que nous avons depuis deux siècles de notre propre fonctionnement cérébral. Le cerveau ne serait qu’une machine. Admettons. Mais quel type de machine ? Au XXe siècle, la “machine reine” est sans aucun doute l’ordinateur. Mais au XVIIIe, il s’agissait de la pendule, qui a pénétré profondément l’inconscient collectif cognitif au point que, lorsque des turbulences paradoxales sont venues agiter la sphère paradigmatique (Relativité, quanta), on n’a eu de cesse de décrire les “paradoxes” de la théorie avec des montres et des horloges, celles même de l’époque des perruques poudrées, ainsi qu’avec le nec plus ultra de la machine à vapeur du XIXe, le train. Or la pendule est une mécanique, c’est à dire qu’elle transmet le mouvement en pas à pas, que l’on peut suivre d’un rouage à l’autre jusqu’aux aiguilles sur le cadran. Aux XVIIIe et XIXe siècles, une théorie scientifique se présentait comme un discours rationnel qui, à partir de prémisses, de rouage logique en rouage logique, amenait au résultat affichable sur un “cadran” mental13.
Au XVIIIe siècle, à partir du principe de Newton, on déduisait les “lois cadrans” comme celles de Kepler pour les planètes14. Au XIXe, à partir de la théorie des corpuscules matériels n’interagissant les uns sur les autres que par chocs, on a déduit le comportement des gaz dits parfaits, la “loi cadran” de Mariotte-Bove : pv = constante. L’élaboration de théories nouvelles ne se concevait que comme une gigantesque horloge à rouages conceptuels, et cette image est restée longtemps à la base des réflexions. Bertrand Russell cherchait une machine capable de développer des théorèmes mathématiques. A la fin de sa vie, il a conclu à son impossibilité, pour la simple raison qu’une théorie n’est qu’un modèle et qu’un modèle n’apparaît pas de manière mécanique, qu’il n’est jamais balistique. Pourtant, les premiers modèles (théoriques) d’ordinateurs, en particulier la machine de Turing, sont le nec plus ultra de cette conception.
Cette vision épistémologique pouvait encore se soutenir dans les années 60. Mais c’est alors qu’est apparu le besoin de “machines experts” où les processus de calcul, s’ils pouvaient être imités par des machines de Turing, s’avéraient pourtant moins efficaces que le cerveau humain. La reconnaissance de forme, par exemple, reste encore un problème non résolu par les meilleurs logiciels (au sens de l’efficacité)15. La recherche actuelle s’oriente donc vers les machines quantiques : plusieurs processus s’élaborent au même moment, de manière délocalisée, dans tout l’appareil. Les rouages de l’horloge conceptuelle se diluent dans une bouillie apparente plus infâme que l’aspect de la machine d’Antikythèra lors de sa découverte au fond de la Méditerranée. Et pourtant les métaphores sur le “cerveau ordinateur” continuent. Mais n’a-t-on pas eu recours, pour décrire l’énergétique du vivant, à des métaphores sur le moteur des automobiles ou des avions, telles que la nourriture aurait fourni le “carburant” et la respiration le “comburant” nécessaires à l’activité motrice ?
La machine n’est pas la mécanique
Toutefois, même la pendule de nos ancêtres n’est pas qu’une simple mécanique. Il s’agit d’une “machine”. Il est remarquable, de ce point de vue, que les hommes du XVIIIe siècle aient rencontré tant de difficultés conceptuelles pour expliquer le système auto-entretenu (par poids ou ressorts) qui assurait la régularité du mouvement des horloges. A la même époque, pourtant, la célèbre Encyclopédie montrait déjà le mécanisme du “baille-blé”, un appareil régulateur de la distribution des grains de blé à la meule d’un moulin. L’information sur le débit à la sortie (la meule) était transmise à un mécanisme situé en amont qui ralentissait ou accélérait le débit de manière à ce qu’il reste globalement constant. Les ailes du moulin tournaient plus ou moins vite selon les besoins, grâce à un ingénieux système adapté de la marine à voile. Un autre exemple contemporain serait le régulateur à boule de Watt pour la machine à vapeur, première véritable régulation d’un moteur. Ici, nous n’avons plus affaire à une simple mécanique mais à une “machine”.
Les Français des couches moyennes, dans les années 50, ne connaissaient encore que le “baille-blé”16, alors que les systèmes de régulation étaient subtilement employés partout, en TSF par exemple avec les systèmes autodyne, hétérodyne, superhétérodyne... Il aurait même suffi de démonter un phonographe à manivelle pour s’apercevoir que le régulateur à boule de Watt était encore utilisé pour réguler la stabilité de la vitesse de rotation du disque. C’est sans doute de cette époque que date, chez les non-spécialistes, la confusion entre machine et mécanique, automate de Vaucanson et “automatisme” au sens scientifique du terme.
La machine, au sens industriel du XIXe siècle, ou l’automatisme au sens scientifique apparaissent dès que l’on peut discerner l’existence de boucles de régulation. De tels phénomènes n’existent pas qu’avec un support mécanique, on en trouve en chimie biologie, en électronique, en écologie, etc. De quoi s’agit-il ? Un système, à partir de l’impulsion originelle, développe un processus jusqu’à son terme au cours du temps. A la sortie, un capteur constate le résultat ; l’information est renvoyée sur l’entrée pour corriger les éventuelles aberrations du phénomène. Le rebouclage peut être volontaire, comme dans une cuve où l’on fabrique en continu un produit chimique donné ; ou involontaire et l’on parle alors d’auto-régulation, par exemple en écologie lorsque les plantes et l’ensemble du calcaire terrestre régulent la quantité de gaz carbonique présent dans l’atmosphère. Or si nous dépassons le simple point de vue matériel, si nous passons à l’élaboration non plus d’un produit mais d’information ou de structure d’information, nous nous apercevons que le processus de théorisation fonctionne exactement de la même façon — et ceci n’est pas uniquement valable pour les théories behavioristes ! On entre des hypothèses, le réel répond (vérification expérimentale). Ce que le réel renvoie nous permet de rethéoriser et de formuler de nouvelles hypothèses, etc. Est-ce un cercle vicieux ?
Le problème de l’observation
Un moyen perfide mais efficace de se créer des paradoxes est encore de ne pas comprendre, dans certains cas, la nécessité de facto et de operatione du rebouclage. On sait en physique que le comportement des particules élémentaires est perturbé par la mesure. En biologie, la présence d’un rayon lumineux sur le microscope augmente la chaleur : les bactéries observées sur la plaquette vont se multiplier plus vite que dans les conditions naturelles. Peut-on penser que refroidir la platine suffirait à corriger cet effet ? Non, car les gradients de température vont encore différer des conditions naturelles. De toute manière, l’observation altérera leur comportement. Ceci n’est pas gênant lorsqu’il s’agit d’établir la présence de tel ou tel agent pathogène dans le sang. Mais quand on cherche des interactions fines, telles que le parasitage de bactéries par un virus modifié ou l’échange de molécules chimiques intracellulaires, cette perturbation n’est plus négligeable.
Que se passe-t-il dans des domaines encore plus subtils et complexes, bien que macroscopiques, comme le comportement de groupes humains ? La plupart des sociologues, à l’heure actuelle, tiennent compte en théorie de “l’effet d’enquêteur” ; encore que, dans la pratique, ce ne soit pas des plus apparents. Mais le scandale de la révélation du “projet MK-ULTRA” aux Etats-Unis permet de mettre en évidence qu’il ne suffit pas de “lancer la pierre et cacher la main” pour obtenir une réponse “objective” du réel social. Les services secrets américains avaient lancé sous ce nom de code une série d’expériences “médicales” et psychosociales sur certaines couches de la population, expériences menées à l’insu des protagonistes17. Or, en regardant l’évolution de la société américaine et de son folklore vivant, on s’aperçoit que dès cette époque (entre 1949 et 1952) une angoisse diffuse se fait jour et se traduit par un déplacement quasi-onirique du problème. Les services officiels américains sont ouvertement accusés par des journalistes de renom comme Keyhoe de cacher à la population “l’horrible vérité” — non pas celle d’une expérimentation impensable, mais le risque d’invasion des USA par des “extra-terrestres” venant en soucoupes volantes18. Après la révélation du projet MK-ULTRA, le déplacement thématique, loin de s’affaiblir, va envahir tout le champ du quotidien et donner lieu à un mythe virulent : Truman, selon cette ghost story collective, aurait signé un pacte secret avec de teigneux petits ET, les Grays, qui disposeraient depuis lors de bases souterraines sous le camp de Nellis AFB ; ils se livreraient à des mutilations animales, enlèveraient hommes et femmes pour récolter du matériel génétique, rendraient ainsi enceintes d’hybrides de jeunes femmes qui seraient enlevées une nouvelle fois pour avortement et récupération des foetus par les ET ; ces foetus, selon la version douce seraient élevés en couveuse, mais nécessiteraient pour survivre de nouveaux enlèvements ; la version dure n’y voit qu’une ferme d’organes pour transplantations ultérieures ; enfin, last but not least, toute cette ténébreuse affaire serait monitorée par une agence fédérale ultra-secrète, le Majestic 12 ou Majic. Encore ne donnons nous ici que la carcasse de cette rumeur foisonnante, qui s’accompagne de vécus mythiques d’enlèvement, incorporés à la mémoire de vie quotidienne des abductees19. Ce cauchemar collectif pourrait se résumer en un cri : “Ils nous traitent comme des choses !” Il est aussi largement responsable du succès de séries TV comme X-Files. On peut voir au travers de cette affaire à quel point il est vain de vouloir mener une étude sur la “matière sociale” en évitant les “paradoxes de la mesure”. Certes, le public américain n’a pas décelé l’expérience réelle menée par ses services spéciaux. Mais il l’a immédiatement traduite en expérience fantasmatique dont nul, à l’heure présente, ne peut prévoir l’évolution, et qui dure depuis 50 ans.
Dans les études sur le rêve, de tels effets, bien que moins dramatiques, peuvent se produire. Il serait absurde pour un chercheur de penser que sa propre théorisation n’a aucun impact sur le rêve et réciproquement. Comment alors agir malgré ce couplage inhérent à toute observation ? Les physiciens quantiques, qui ont les premiers découvert cet effet perturbateur, n’avaient certes pas à se poser en plus des questions méthodologiques de graves problèmes d’éthique et de déontologie — du moins pas avant Hiroshima. Cependant, leurs approches pourraient être éclairantes pour les sciences humaines en général et l’onirologie en particulier.
La théorisation comme automatisme
Donc, d’une façon relativement simple, on peut assimiler tout effort de théorisation à un automatisme au sens scientifique du terme, automatisme dont l’objectif (au sens de but de la régulation) est la meilleure représentation possible du réel. Dans un automatisme, le temps de transfert sortie => entrée, et celui de l’élaboration du système correctif jouent un rôle important. On peut, selon le cas, obtenir ainsi un résultat rapidement stable ou un système oscillant qui tend progressivement vers la solution. Pour une théorisation, l’oscillation pourrait se faire entre formulation et remise en question. Mais il existe des cas où le système est fragile au point que cette oscillation s’accroît, parfois même jusqu’à mener le système à un état où sa propre intégrité peut être compromise. En chimie, cela peut se traduire par l’explosion de la cuve ou par la fabrication involontaire d’un produit non désiré. En histoire, nous pouvons voir ce processus dans l’évolution de certaines sociétés, où l’on essaie tour à tour des solutions opposées pour tenter par exemple de stabiliser une défaillance économique. Mal conduit, ce processus a pour effet d’augmenter le désordre, et parfois jusqu’au point où l’intégrité de cette société est remise en cause. Elle subit alors une crise après quoi elle prend un aspect tout à fait différent. La révolution française et les événements qui l’entourent en donnent un bon exemple. Dans ce cas précis, si la tentative de régulation sous les divers ministères du règne de Louis XVI n’a pas atteint son but, ce n’est pas pour avoir mal défini les objectifs ; les problèmes étaient clairement posés, y compris par le roi ; mais le temps nécessaire à la prise de conscience et à la prise en charge des déséquilibres était trop lent pour une société trop fragile. Il se peut que certains échecs retentissants dans les cures psychanalytiques puissent être aussi simplement le fait d’un mauvais rebouclage patient/praticien.
D’autres phénomènes entrent en jeu, des réflexions au sens propre du terme, renvois énergétiques ou conceptuels qui peuvent entraîner des phénomènes de résonance et altérer le comportement du système de manière considérable. Ainsi la pratique des vacances d’été et d’hiver, dont une conséquence directe est une surconsommation saisonnière du parc automobile, a-t-elle un effet de résonance sur le comportement climatique où l’on décèle depuis quelques années une composante saisonnière de 6, 4 et 3 mois, de plus en plus importante dans l’évolution des précipitations et des températures20. Dans l’étude du rêve, on peut constater aussi des couplages involontaires de ce genre. Certaines expériences oniriques comme la lucidité seront ainsi reproductibles par certains et non par d’autres. Les hypothèses de travail des chercheurs de l’ASD deviennent fréquemment des dogmes intangibles dans le dream network américain, approchant même d’attitudes cultistes21.
D’une manière générale, tout automatisme renvoie à la sortie un signal à deux composantes :
1. Celle qu’aurait le signal d’entrée si rien ne venait perturber le processus. Dans le vivant, cette composante est très souvent de type exponentiel.
2. Une composante de type périodique complexe qui représente l’interprétation complexe de la façon dont le système répond d’une manière générale aux sollicitations en entrée.
Si le rêve est couplé avec les théories onirologiques, indépendamment du bruit de fond, il faut s’attendre à ce que la théorisation évolue de manière cumulative mais aussi, comme dans toute autre science, à ce qu’interviennent des “retours” à des paradigmes antérieurs (effet cyclique complexe)22.
L’automatisme quantique
Jusqu’ici, nous avons traité de ces problèmes dans un cadre classique. Mais si des phénomènes de type quantique apparaissent, (apports en “paquets” et non sous la forme d’un “fluide” continu), la question se pose de manière quelque peu différente. Une partie du phénomène est continue et obéit statistiquement à la loi des grands nombres. Si un événement a 10 % de chances de se produire, pour 1 million de cas semblables, 100 000 environ présenteront l’événement prévu. Mais si l’information se transmet de façon quantique, par sauts brusques, nous observerons un comportement paradoxal du système dans quelques cas particuliers intéressants, surtout s’il est traité de manière à l’isoler. Les réflexions énergétiques ou informationnelles sur les “parois” feront que le phénomène obéira en pratique à la loi de Guérin. Bien qu’elle ait été définie pour l’ufologie, elle s’applique à de nombreux autres domaines : “En ufologie, toute hypothèse apparemment prouvée est démolie par les observations suivantes”. Plus on veut isoler le système, comme l’énergie disponible pour ce faire n’est pas infinie, plus les barrières seront hautes et plus elles seront fines, et plus un objet “confiné” à l’intérieur s’échappera volontiers23.
Dans une théorie cognitive, les “barrières” sont les affirmations d’impossibilité. Nous reviendrons ultérieurement sur cette question essentielle. En onirologie, la loi de Guérin pourrait se formuler ainsi : “Toute théorie sur le rêve qui affirme un contenu onirique impossible se voit contredite par les faits souvent même à brève échéance.” Nous en donnerons deux exemples, à partir du rêve lucide. Hervey de Saint Denys, à propos de ses rêves lucides érotiques, estimait impossible d’atteindre l’orgasme24; Patricia Garfield conseillait de pousser l’expérience jusque là mais prétendait que l’orgasme onirique nécessitait un entraînement25. A peine publié son ouvrage majeur, le rêveur lucide Henri R. témoignait de ce que son premier RL accidentel avait été érotique et orgasmique. D’autre part, dans le n°1 de Rêver, Paul Tholey argumente sur l’impossibilité de maîtriser les lumières en RL et, dans le n°3, Alan Worsley explique que ce n’est qu’une question de retard de l’effet sur la formulation de l’attente, que donc l’impossibilité présumée n’est qu’un artefact. A quand le pyrotechnicien onirique virtuose ?
La mise en évidence de la loi de Guérin en onirologie ne représente pas seulement pour nous un phénomène agaçant, mais elle permet de constater :
1. l’existence du couplage rêve/théorie onirique.
2. que, si l’information qui nous parvient est assimilable à un phénomène quantique, on ne peut pas décider de l’inexistence totale des phénomènes prévus par la théorie, ou de leur certitude absolue.
Cette indécidabilité elle-même, lorsqu’on la constate, peut faire penser qu’un couplage est en oeuvre, mais à quel niveau et de quelle nature, on l’ignore. La théorie de l’automatisme quantique, corrélée à la théorie de l’information, permet au moins de l’affirmer. Ce qui n’est pas une négation sur quelque chose qui ne devrait pas exister !
Notes
1) A. H. W. Beck, Les télécommunications, Hachette, Paris, 1967, p.191.
2) René Thom, Modèles mathématiques de la morphogenèse : recueil de textes sur la théorie des catastrophes et ses applications, 10/18 n° 887, Paris, 1974, pp. 7-9.
3) C. E. Shannon et W. Weaver, The mathematical theory of communication, University of Illinois Press, 1949.
4) On peut établir en physique fondamentale une équivalence information/énergie aussi bien qu’une équivalence énergie/matière. Les lois qui permettent de passer de ces principes de base au comportement réel des particules sont évidemment plus complexes que ne le laisse penser ce raccourci. Voir par exemple Olivier Costa de Beauregard, Le second principe de la science du temps, Seuil, 1969.
5) Ce terme n’est qu’une plaisanterie classique de laboratoire. Il compare le chercheur enthousiasmé par une nouvelle théorie au petit canard qui, au sortir de l’oeuf, reçoit l’empreinte de la première chose qu’il voit bouger devant lui et se met à la suivre, qu’il s’agisse de sa mère, d’un ballon ou de l’expérimentateur.
6) Cité par Yvonne Castellan, La Métapsychique, PUF, Paris, 1960, p. 40.
7) Communication personnelle d’Anita Tullio à Geneviève Béduneau, qui nous en a fait part. On comprendra que nous laissions dans l’anonymat l’astronome en question, à la demande d’Anita Tullio de qui ce dernier l’a exigé. Mais les lecteurs qui seraient par hasard “du métier” n’auront pas de mal à reconnaître qui pousse à ce degré la misanthropie.
8) Rêver n°2
9) Ce type d’étude sur le contenu onirique a été effectivement réalisé par des sociologues américains dans les années 60-70, y compris sous Nixon une célèbre enquête cross-cultural devant déterminer les ressemblances et les différences entre les rêves d’étudiants américains et chinois. Les résultats furent à la mesure du questionnaire employé...
10) Voir à ce propos Klein, Etude polygraphique et philogénique des états de sommeil, thèse de doctorat, Bosc ed. ; Jean Jacques Walter, Planètes pensantes, Denoël, Paris, 1980, p.57 ; Stephen LaBerge, Le rêve lucide, trad. Ripert, Béduneau, et al., Oniros, Paris, 1991 (1ère ed. Lucid Dreaming, 1985), pp. 231-132 ; Roffwarg, Muzio, Dement, “Ontogenic development of the human sleep-dream cycle”, Science n°152, 1966, pp. 604-619 ; Michel Jouvet, Le sommeil et le rêve, Odile Jacob, Paris, 1992.
11) Jouvet, op. cit.
12) D’où l’importance, à notre avis, des travaux de Christian Bouchet.
13) Remarquons d’ailleurs la prédominance du cadran dans l’affichage des appareils de mesure d’époque, qu’il s’agisse de pression, de volume liquide ou gazeux transitant par un tuyau, parfois même de température.
14) Kepler avait certes formulé ses lois avant Newton. Mais l’introduction d’un nouveau principe en science entraîne tout un travail de réélaboration du connu, qui doit alors se déduire de ce principe. C’est même une façon d’en tester la validité.
15) D. Forsyth, J. Malik, R. Wilensky, “La recherche d’images numériques”, Pour la Science n°238, août 1997, pp. 86-89.
16) Et encore... Sa description présente dans les manuels du Brevet Elémentaire d’avant-guerre avait disparu du programme du BEPC, sans parler de ceux du Bac.
17) Rappelons qu’il ne s’agissait de rien de moins que de faire consommer de la nourriture irradiée à des enfants déficients mentaux, d’incorporer des drogues psychotropes à l’alimentation, et autres diableries destinées à tester l’effet de certaines armes. Les expériences furent conduites sous l’administration Truman au début des années 50 et révélées en 1974, au moins partiellement, grâce au Freedom of Information Act qui autorise la déclassification au bout de 12 ans de documents n’intéressant plus directement la défense nationale américaine. On retrouve encore des victimes de ces agissements illégaux. Voir à ce propos l’articulet “Irradiés en Arizona”, Science et Vie n°930, mars 1995, p. 12.
18) Donald Keyhoe, Flying Saucers are real, New York, Fawcett Publications, 1950.
19) Budd Hopkins, Intruders, Random House, 1984 ; Whitley Strieber, Communion, Wilson and Neff Inc, 1987 ; Transformation, Wilson and Neff Inc, 1988 ; Majestic : the government lies, Wilson and Neff Inc, 1989. Ces ouvrages, ainsi que le film Hangar 18, ont été les principaux propagateurs médiatiques du mythe.
20) Cet effet se calcule aisément en reprenant les données quotidiennes de Météo France, mais n’a pas fait l’objet de publications détaillées en dehors des supports spécialisés, non commerciaux.
21) Voir le témoignage de Bette dans ASDNewsletter vol. 8 n°4, 1991.
22) C’est ainsi qu’en physique la théorie corpusculaire de la lumière établie par Newton a été abandonnée au profit d’une théorie ondulatoire lors de la mise en évidence par Young de franges d’interférence. Mais cette théorie corpusculaire est revenue, sans abandon de la théorie ondulatoire, avec Einstein et la découverte du photon pour expliquer l’effet photo-électrique.
23) Il s’agit de l’effet tunnel qui explique entre autres la radioactivité et l’évaporation des trous noirs. Nous faisons grâce au lecteur de la justification mathématique de cet effet “paradoxal”.
24) Hervey de Saint Denys, Les rêves et les moyens de les diriger, Paris, 1867.
25) Patricia Garfield, La créativité onirique : du rêve ordinaire au rêve lucide, trad. R. Ripert, La Table Ronde, Paris, 1983. Première édition américaine 1974.